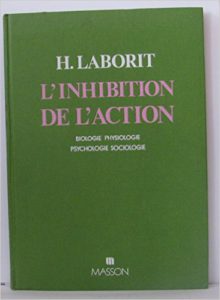
Comme je l’ai expliqué ici, je donne cet automne un cours sur la cognition incarnée à l’UQAM. Chaque lundi, je publie dans le blogue du Cerveau à tous les niveaux un résumé de la séance que je donne le mercredi suivant. Et chaque vendredi, je fais ici des liens entre le travail de Laborit et le thème de la semaine (les présentations des séances du cours en format pdf sont disponibles ici).
J’aimerais introduire le sujet de cette semaine par un petit préambule. En science peut-être plus que dans tout autre domaine, les mots, et les réalités qu’ils tentent de décrire, orientent et contraignent notre pensée. Le langage est un formidable outil pour coordonner nos actions, mais il importe de se rappeler de temps à autre qu’il est aussi « le moins pire ». Dans le sens où la réalité sera toujours plus complexe que ces étiquettes consensuelles, marquées dans le temps et l’espace, que sont les mots. Or les sciences cognitives ayant l’ambition de s’aventurer dans l’objet le plus complexe de l’univers connu, le cerveau humain, pour mieux le comprendre, il n’est pas étonnant qu’il faille constamment revoir les étiquettes qui nous servent à l’explorer.
C’est un peu la leçon qu’on peut tirer de notre rapide survol du livre de Michael Anderson, After Phrenology, résumé dans le billet de lundi dernier. Ce point ressort toutefois assez peu de ce résumé parce qu’il fallait rentrer un peu, justement, dans la complexité de la controverse sur la spécialisation des régions cérébrales (ce qu’on a fait un peu plus durant la séance de mercredi) pour en saisir l’importance. Pour comprendre pourquoi, par exemple, Anderson insiste tant pour que l’on parle davantage de « différentiation » des régions cérébrales plutôt que de « spécialisation », cette dernière laissant sous-entendre qu’un fois que l’on aurait trouvé une tâche ou une fonction psychologique qui active une région donnée, on saurait quelle est sa spécialisation et l’histoire s’arrêterait là. Alors que ce que l’on découvre pour à peu près toute région cérébrale, aussi petite soit-elle, c’est qu’elle est activée par de nombreuses tâches ou situation de la vie courante. Et elle l’est toujours en parallèle avec plusieurs autres, formant des coalitions transitoires de plusieurs régions différentiées, donc des régions simplement capables d’apporter une contribution computationnelle particulière à l’ensemble.
On voit donc comment un simple changement d’étiquette conceptuelle peut nous sortir d’une impasse, en l’occurrence ici celle qui oriente une majorité d’étude en imagerie cérébrale depuis ses débuts, l’obsession du « où » dans le cerveau. Car s’il existe une (et une seule) région spécialisée pour telle ou telle fonction, on veut automatiquement savoir où elle se trouve, rien de plus normal ! Or les choses semblent de moins en moins se révéler selon cette logique…
Quel est le lien entre ce préambule et Éloge de la suite ? C’est que je pense que Laborit a contribué à nous sortir de certaines ornières conceptuelles à plusieurs reprises lui aussi. Je pense à deux exemples en particulier.
D’abord les fameux « mécanismes de défense » qu’il fallait, dans les années 1940, toujours favoriser, même sur la table d’opération. Et ce que Laborit allait comprendre, et qui allait mener aux succès de ses cocktails lytiques pour atténuer les effets du choc opératoire, c’est que ces mécanismes de défense, on devait comprendre d’où ils venaient pour savoir s’il fallait à tout prix les préserver. Car favoriser avec des drogues la vasoconstriction sanguine dans les organes comme le foie ou l’estomac comme on le faisait à l’époque, c’était au fond vouloir accentuer une réaction organique globale de redistribution des ressources sanguine visant avant tout à favoriser l’action devant un danger, donc les muscles striés. Or Laborit comprit que sur la table d’opération, le ventre ouvert, un patient ne peut pas fuir ou lutter contre une menace. Il devenait donc inutile de favoriser cette réaction et même dangereux de le faire car au bout d’un moment cette irrigation réduite avait des effets délétères sur les organes en question.
Cela semble évident aujourd’hui, mais quand dans les années 1940 on vivait depuis des décennies avec un dogme formulé de manière aussi logique que « favoriser les moyens de défense » (qui voudrait défavoriser une « défense » ?), ce n’est pas si évident à dépasser. Un peu comme toutes ces études d’imagerie qui cherchent à situer telle ou telle région « responsable de » telle fonction, puisque la vision modulaire de l’esprit que porte encore l’idée d’aire spécialisée incite logiquement à chercher une localisation précise pour chaque catégorie psychologique.
L’autre exemple qui me vient à l’esprit est l’expression « inhibition de l’action » mise de l’avant par Laborit. Car ayant compris les conséquences sociales des réactions organiques au stress que son ami Hans Selye avait mis à jour, Laborit a vu à quel point ces effets néfastes pour la santé découlaient directement d’une impossibilité de fuir ou de lutter contre une menace réelle ou perçue, donc d’agir. Il a même étudié les bases cérébrale de ce système qui peut, dans certaines situations pas trop prolongées, être adaptatives. Je pense à ce petit rongeur qui aperçoit un rapace au-dessus de lui et ne peut lutter ni fuir sans être repéré, alors il fige et espère passer inaperçu. Même chose pour l’employé qui ne peut fuir son boulot parce qu’il a une famille à nourrir ou sauter au cou de son patron qui vient de l’insulter car il aurait des ennuis avec la police… Alors il peut « prendre sur lui » et attendre que ça passe. Mais s’il reste dans cet état d’inhibition de l’action trop longtemps, son système étant alors tout entier alors orienté vers l’action (qui ne se fait pas), les organes associés à la digestion ou au système immunitaire seront mal irrigués. Et cette mauvaise irrigation sanguine aura un effet dévastateur sur sa santé si elle persiste trop longtemps.
Voilà pourquoi parler « d’inhibition de l’action », au lieu de simplement « stress » ou même « stress chronique », nous permet de comprendre beaucoup mieux ce qui se passe en nous dans de telles situations. Cela, Laborit l’avait bien compris, lui qui, comme Michael Anderson, montre qu’il faut parfois changer le vocabulaire pour sortir des ornières conceptuelles qui nous empêchent de progresser dans notre compréhension des processus complexes qui nous animent.